Un blog pour « donner la parole à ceux pour qui la thèse a été une expérience positive »
Fondé en 2013, le Réseau national des écoles doctorales en sciences pour l’ingénieur (Redoc SPI) compte une trentaine d’écoles doctorales membres. Sa mission ? Promouvoir le doctorat en SPI à travers différentes plateformes. Alain Bamberger, président du réseau, revient sur l’une d’entre elles : le blog Docteurs SPI, qui met en lumière des expériences doctorales positives et les parcours qui s’ensuivent.
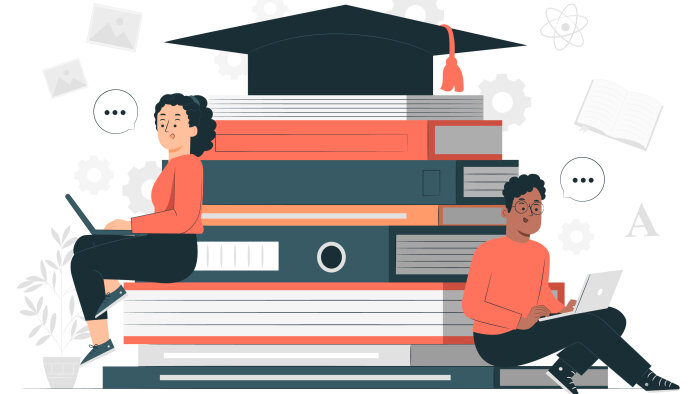
Pourquoi avoir lancé ce blog ?
Alain Bamberger : J’ai proposé l’idée à mes collègues du Redoc SPI après avoir lu plusieurs articles du Monde sur la thèse ; souvent à connotation négative, notamment dans les sciences humaines. L’image que renvoient ces articles est loin de correspondre à la réalité de tous les doctorants. Nous avons par exemple beaucoup de témoignages de doctorats en conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre), avec un projet professionnel bien défini, qui sont satisfaits de cette expérience.
Le blog Docteurs SPI est donc né, en 2022, afin de donner la parole à celles et ceux pour qui le doctorat a été une expérience positive. La formule choisie est celle de l’auto-interview : les personnes qui témoignent posent et répondent aux questions par écrit. À ce jour, j’ai refusé un seul témoignage. Sinon, les auteurs ont carte blanche : je ne modifie pas un mot.
Comment de personnes touchez-vous ?
Docteurs SPI compte déjà 360 témoignages, en français et en anglais. 30 % de ces prises de parole viennent de femmes. Le blog est consulté par plus de 15 000 personnes par an.
80 % des témoignages que nous publions viennent des sciences pour l’ingénieur, avec quelques contributions en mathématiques, informatique et en chimie. Chaque année, 2 000 doctorants s’engagent en sciences pour l’ingénieur.
Quels formats souhaitez-vous développer ?

Je contacte les auteurs en m’appuyant sur LinkedIn. Mon souhait est que le blog se développe avec l’implication des laboratoires en SPI. Idéalement, j’aimerais qu’il fonctionne presque de manière autonome, porté par les unités de recherche. Cela jouerait aussi sur la diffusion des témoignages.
J’envisage aussi des modes de témoignages un peu différents, par exemple un format où les doctorantes et doctorants s’expriment plus librement. Un modèle possible serait celui d’un carnet de thèse, dans lequel un doctorant partagerait ses réflexions régulièrement.
Enfin, j’imagine aussi une collection intitulée « Pourquoi font-ils une thèse ? » basée sur un sondage, pour comprendre les motivations initiales. Enfin, j’aimerais réaliser une série de témoignages avec des docteurs dix ans après leur thèse.
Quel lien avec Redoc SPI ?
Le blog est lié au site de Redoc SPI, une association dont le but est aussi de montrer qu’un grand nombre d’entreprises emploient des docteurs, notamment des PME.
Quelques bonnes feuilles à recommander ?
J’aime beaucoup les profils internationaux. Celui de Shivangi Shree, par exemple, une Indienne qui a fait sa thèse à l’Insa Toulouse et qui souligne l’importance de choisir un sujet de thèse par passion pour un sujet, tout en étant conscient du défi que cela représente.
Autre témoignage à découvrir : celui de Léa Mangani, qui a fait une thèse Cifre sur les batteries, motivée par l’intérêt pour la recherche appliquée et les débouchés en R&D. Elle insiste sur l’importance d’un bon encadrement, de l’organisation et de la confiance en soi pour réussir un doctorat, tout en évoquant les inégalités de genre dans les métiers scientifiques.
Enfin, celui de Michelle Nassar, qui a réalisé une thèse en ingénierie électrique à l’Institut Pprime (CNRS). Aujourd’hui ingénieure à Schneider Electric, elle souligne l’impact de la thèse sur sa rigueur, ses compétences transversales et son engagement à promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes filles.
- Consulter le blog Docteurs SPI.