Un chercheur témoigne dans son livre : « La précarité gagne tout le monde »
Normalien, élève à Sciences Po Paris, docteur en sociologie : le parcours de Charles Bosvieux-Onyekwelu ne le prédestinait pas à la précarité. Et pourtant, il l’a vécue dès le doctorat et continue à l’observer en tant que chargé de recherche au CNRS. Encore aujourd’hui, une rage l’anime devant bien des situations inacceptables… Ce vécu, il le partage dans l’ouvrage Précarité générale : témoignage d’un rescapé de l’Université, publié le 13 septembre aux éditions Textuel.

À l’occasion de la sortie de son livre Précarité générale : témoignage d’un rescapé de l’Université (2023, Textuel), le chercheur en sociologie de l’action publique et des élites du Centre Norbert Elias, Charles Bosvieux-Onyekwelu, répond à Campus Matin.
Quelle est l’origine de ce livre ?

Charles Bosvieux-Onyekwelu : Cet essai est parti d’un courriel envoyé sur les listes de diffusion professionnelles de la sociologie, en janvier 2021. J’y parlais, en me fondant sur ma propre expérience, de la précarité grandissante qui sévit dans l’ESR. Les directeurs de la collection « Petite Encyclopédie critique » de la maison d’édition Textuel l’ont lu et m’ont contacté pour savoir si je pouvais en faire un témoignage plus long, publié sous la forme d’un livre.
Qu’est-ce qui a inspiré votre témoignage ?
Il y a des éléments empruntés à mon vécu dans la recherche, d’autres tirés d’échanges avec des collègues. J’ai aussi lu les travaux des autres chercheurs et chercheuses, n’étant pas spécialiste de ces sujets. Je ne prétends pas avoir mené une vraie enquête en sciences sociales. Cependant, même s’il est fondé sur mon expérience personnelle, mon livre est informé, documenté et enrichi de chiffres qui permettent d’objectiver mon propos.
Son message, si je devais le résumer : dans l’ESR, on n’en peut plus.
À qui s’adresse-t-il ?
Il s’agit d’un livre de diffusion scientifique, qu’on pourrait catégoriser comme un livre d’intervention. J’espère que des collègues, pas uniquement des sciences sociales, le liront. Il s’adresse aussi au grand public, aux gens qui connaissent mal l’université, qui croient qu’être universitaire se résume à faire quatre heures de cours par semaine…
Travailler à l’université aujourd’hui, c’est, à peu de choses près, comme travailler aux urgences !
Je voudrais que soient connues les conditions de travail des gens chargés d’enseigner aux étudiants et de produire la connaissance fondamentale en France. Travailler à l’université aujourd’hui, c’est, à peu de choses près, comme travailler aux urgences !
Quelle forme prend-il ?
Dans le premier chapitre, je raconte d’où je viens — d’un milieu social privilégié qui ne me prédisposait pas à connaître tant d’instabilité. J’explique ensuite en quoi consiste la précarité dans l’ESR, comment je l’ai expérimentée. Puis, j’essaie de monter en généralité en me demandant ce que la précarité que j’ai vécue a de propre à mon secteur, ce qu’elle a en commun avec la précarité du reste du monde du travail, et comment on pourrait en sortir.
Quels constats tirez-vous de cette comparaison entre précarité de l’ESR et du secteur privé ?
L’impression générale est que la précarité progresse dans le monde du travail, mais, quand on regarde les données issues des enquêtes emploi de l’Insee ou de la DARES (qui se situent à un niveau agrégé), on s’aperçoit que le CDI reste majoritaire. En revanche, quand on compare le temps qu’il faut pour avoir un CDI aujourd’hui par rapport au début des années 80, on s’aperçoit qu’il augmente significativement.
Dans la fonction publique, si l’on regarde le ratio titulaires/contractuels, on s’aperçoit que l’emploi stable dans certains secteurs est rare et qu’on y accède tardivement. C’est aussi le cas dans d’autres secteurs non lucratifs, comme les ONG ou le monde associatif, ou dans des secteurs où le profit ne va pas de soi, comme le journalisme.
Pourquoi un poste stable arrive-t-il si tard ?
Le service public de l’ESR ne tient plus que par le professionnalisme de ses agents.
En tant que chargé de recherche ou enseignant-chercheur, on accède à un poste après avoir obtenu un doctorat. A un âge déjà un avancé donc, en moyenne autour de 31 ans. À cela s’ajoute, pour les sciences humaines et sociales, une thèse généralement plus longue que les trois ans prévus (entre quatre et cinq ans). S’ensuit un enchaînement de postdoctorats et de contrats courts en attendant un poste fixe…
Cela donne des carrières non linéaires et des accès à des postes stables autour de 34 ans dans un organisme de recherche et de 35 ans à l’université. À l’âge de 38 ans, dans mon cas, parce que mon parcours de « surdiplômé » m’a fait rester un peu plus longtemps dans l’enseignement supérieur (j’ai soutenu à 34 ans).
J’ai vraiment ressenti la précarité pendant cette période de trois ans et demi entre la soutenance et le recrutement définitif. C’est là que viennent les plus grosses épreuves, qu’il faut publier dans des revues significatives… Et que vous vous confrontez au regard que les autres portent sur vous et votre travail.
Avez-vous pensé à changer de voie ? Quelle était votre motivation pour persister malgré tout ?
Au moment où je luttais pour finir ma thèse, j’étais en mission. Je voulais aller jusqu’au bout, malgré les humiliations, les échecs et les vexations. La recherche, c’était et c’est vraiment ce que je veux faire. Il est indispensable d’avoir cette vocation pour la science, car, quand on ne l’a pas ce carburant, on ne peut pas tenir.
Je ne voulais pas travailler dans une entreprise
Et puis, comme beaucoup de docteurs, je me suis dit, sûrement à tort, que je n’étais bon qu’à ça. Je me projetai dans un poste à l’université ou dans un organisme de recherche, mais rien d’autre. J’ai le service public chevillé au corps. J’ai d’ailleurs fait ma thèse sur sa genèse. Je ne voulais pas travailler dans une entreprise. Mais c’est aussi une grande responsabilité, car, avec un poste financé par les impôts, il faut se montrer à la hauteur des attentes de la société.
Aujourd’hui, le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (comme d’autres services publics) ne tient plus que par le professionnalisme de ses agents : parce que les gens aiment leur métier et partagent cette philosophie.
Quelles sont les humiliations dont vous avez été témoin ?
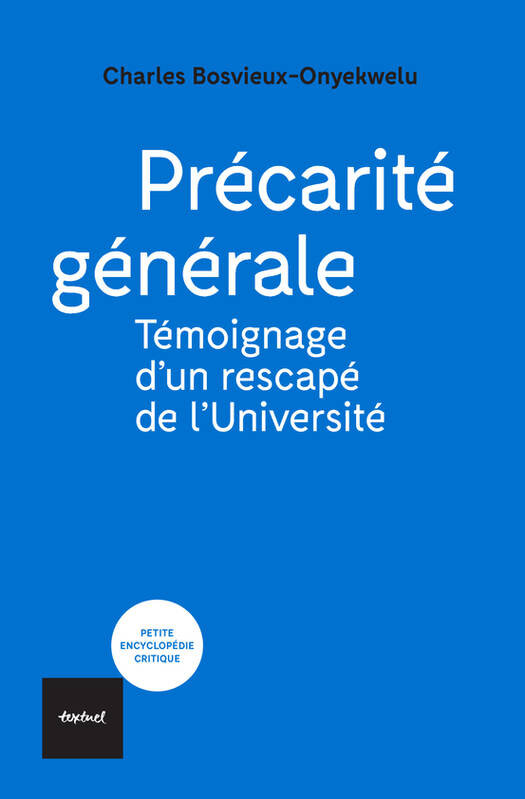
J’ai assisté à des soutenances de thèse qui s’apparentaient à des humiliations. Il y a également tout ce qui a trait aux non-dits vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles (VSS), mais aussi les maltraitances des encadrants envers les doctorants et doctorantes. Faire miroiter un poste pour exploiter encore plus la personne, par exemple. Le livre d’Adèle Combes, Comment l’université broie les jeunes chercheurs, regorge d’exemples à ce sujet.
Je n’avais pas conscience de ces difficultés quand j’ai commencé ma thèse, pourtant je viens d’un milieu qui ne fait pas partie des moins informés. Il faut avoir foi en soi pour vouloir être maître de conférences ou chargé de recherche… ou il faut être inconscient.
Si un étudiant vient me voir pour avoir des conseils sur le doctorat, honnêtement, je le dissuade. Je ne pense pas que ce soit un monde enviable.
Votre vision des choses a-t-elle changé en trois ans de poste fixe ?
La différence principale pour moi est de ne plus être sur un contrat d’un an et d’avoir un salaire qui tombe à chaque fin de mois. En janvier, je n’ai pas à m’interroger sur ce que je vais faire en septembre prochain, ou à me demander si je vais devoir aller enseigner dans le secondaire.
Ce qui n’a pas changé, c’est la rage que j’ai en moi devant des situations que je trouve inacceptables. La Loi de programmation de la recherche a permis quelques améliorations sur la rémunération des personnels titulaires, mais pas une amélioration systémique. Certaines dispositions aggravent même de manière préoccupante la précarité déjà existante.
La précarité gagne tout le monde, même les titulaires.
La précarité, finalement, gagne tout le monde, même les titulaires. Recruter à chaque rentrée des vacataires, répondre à des appels à projets en permanence, devoir se contenter de crédits qui ne suffisent pas… c’est aussi une forme de quotidien précarisé. Quant à la démographie étudiante en hausse, il aurait fallu créer des centaines et centaines de postes d’enseignant-chercheur pour y faire face…
N’avez-vous pas peur qu’un tel ouvrage impacte la suite votre carrière ?
Il faut aller au-delà de cette peur : n’importe quelle personne s’intéressant au sujet peut partager les constats que je fais. Et puis, je suis fonctionnaire titularisé. J’assure le reste : je fais ce qu’on attend d’un chercheur CNRS ; j’enquête, je communique, je publie. Bref, je suis investi dans mon travail, comme tant d’autres collègues.
Quand on réussit, on oublie parfois ce que l’on a vécu. Ces livres de témoignages ne valent cependant que si l’on a réussi. Sinon on vous dira que vous êtes aigri. Pourtant, j’ai reçu beaucoup de messages de collègues qui ont vécu la même chose.
Quels espoirs fondez-vous avec la publication du livre ?
Je ne pense pas que les décideurs actuels liront le livre ou feront le nécessaire pour changer les choses. On ne peut rien espérer de sectoriel. Pour qu’il se passe quelque chose, il faudrait un changement à un niveau structurel. Par exemple, il faudrait arrêter de considérer que le statut de la fonction publique est l’ennemi. Il est au contraire une immense assurance : celle d’être indépendant dans ses recherches.
Du côté des rémunérations, elles devraient être plus élevées pour tous et toutes : doctorants, postdocs, vacataires et titulaires. Sur un plan personnel, j’accepterais de rester à mon salaire si cela signifiait augmenter le nombre de postes de fonctionnaires ouverts au recrutement.
Pour l’heure, j’ai été sollicité par certains médias pour parler du livre, mais pas encore par des universités ou des librairies. J’espère qu’on parlera de ce que le livre met au centre du débat : la décence des conditions de travail, l’avenir de l’université et le service public de la science.