Les établissements privés à vocation professionnelle à la croisée des chemins
La professionnalisation et l’alternance sont au cœur des enjeux de formation dans le supérieur. Si l’apprentissage s’est développé, il fait face aujourd’hui à une problématique de financement, mais également de certification des programmes proposés. Comment les établissements à vocation professionnelle s’adaptent-ils et réagissent-ils ? C’était l’objet d’un webinaire de Campus Matin organisé avec les Entreprises éducatives pour l’emploi (3E).
Cycle : Campus Matin
L’enseignement supérieur privé à vocation professionnelle s’est très fortement développé ces deux dernières décennies, à l’initiative des pouvoirs publics, mais également sous la pression des familles soucieuses de trouver des filières qui allient à la fois professionnalisation, insertion et qualité académique — sans parler de l’ouverture sociale, favorisée par le financement des études ou la rémunération proposée aux alternants.
Trouver un chemin entre deux mondes
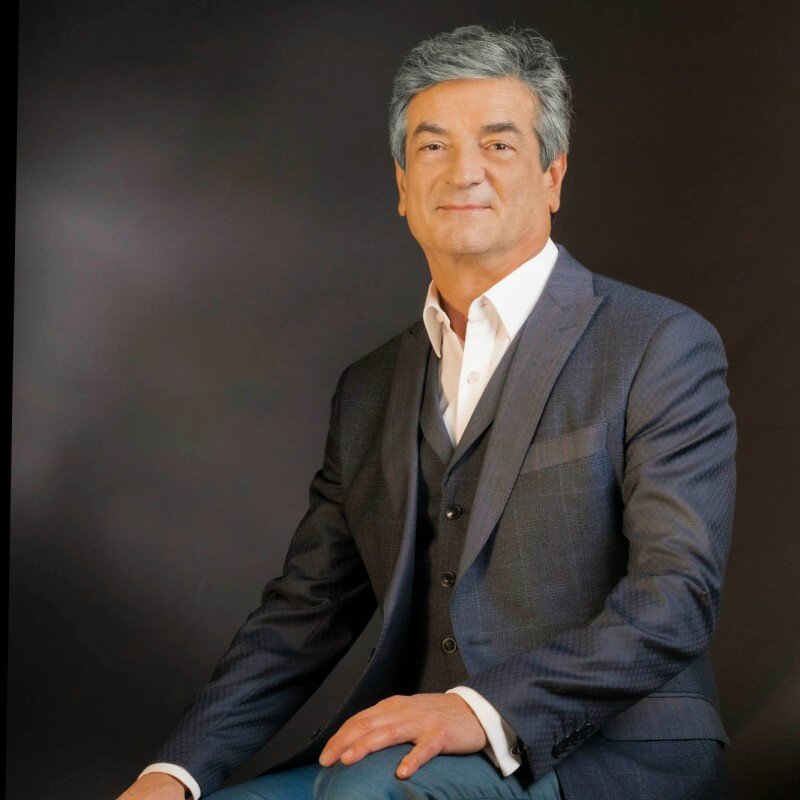
Au moment où la barre symbolique du million d’apprentis est quasiment franchie, de nouvelles problématiques émergent, liées notamment au financement, à la certification des formations ou encore à l’évaluation des opérateurs. D’un côté, les ressources diminuent ; de l’autre, le ministère en charge de l’enseignement supérieur prépare un projet de loi pour offrir une plus grande lisibilité aux candidats et garantir une meilleure qualité de l’offre.
Si personne ne conteste l’objectif général, des acteurs appellent à une reconnaissance de leurs spécificités.
« Les établissements d’enseignement à vocation professionnelle sont nés d’une réflexion menée avec le ministère de l’enseignement supérieur. Nous avons constaté une certaine opposition entre une vision académique et une autre, plus professionnelle. Nos institutions travaillent sous l’égide du ministère du travail et de celui de l’enseignement supérieur, ce qui nous impose de trouver un chemin entre deux mondes », introduit Philippe Grassaud, président de l’Association des entreprises éducatives pour l’emploi (3E).
Faire le tri
La réforme de l’apprentissage engagée en 2018 a fait bouger les lignes et a conduit beaucoup d’acteurs à proposer cette formule, qui, auparavant, était plutôt cantonnée à un nombre limité d’établissements.

« Le paysage a donc été complètement bouleversé. Beaucoup d’opérateurs se sont mis à proposer de l’alternance, dans le privé comme dans le public, dans tous les segments, toutes les disciplines et tous les secteurs. Nous arrivons à un moment où nous avons besoin de faire le tri, pour garantir une certaine excellence », observe Annabel Bismuth, directrice académique du réseau Skolae, qui appelle à labelliser les filières qui ont fait leurs preuves.
Un manque de clarté est apparu sur le marché des formations, et il semble difficile de s’y retrouver, aussi bien pour les entreprises que pour les familles. « À cela s’ajoute un contexte défavorable, avec le décret du 1er juillet 2025 qui impose un coût supplémentaire pour les apprentis du supérieur*. Ce qui fait suite à des aides de l’État déjà réduites drastiquement. Il ne faudrait pas saboter une formule d’études qui coche pourtant toutes les cases », soutient Laura Penel, responsable marque employeur et relations écoles chez TF1.
Des pratiques à encadrer

D’où une certaine incompréhension, côté jeunes, au regard de ce dispositif « qui fonctionne pour tout le monde », insiste Alexis Fournet, apprenti attaché aux relations institutionnelles et partenariats chez TH Conseil. « Il est bon de rappeler que 61 % des apprentis n’auraient pas suivi des études supérieures sans apprentissage, et que, sur les cinq dernières années, le chômage des jeunes a baissé de 5 %. »
Aujourd’hui, il y a donc consensus pour organiser un système mieux régulé de l’apprentissage, afin d’éviter d’éventuelles dérives et - en creux - favoriser une plus grande stabilité des financements. « Une vraie politique est obligatoire. Dans d’autres pays comme l’Allemagne, l’apprentissage est centenaire, son financement établi. En France, il y a trop de stop & go sur des bases politiques ou des mouvements d’opinion, mais pas de vision à long terme. Alors qu’il faudrait simplifier la relation étudiant - entreprise, on a eu tendance à la complexifier », commente Philippe Grassaud.
Encadrer les certifications pour assainir le marché
Autre sujet sensible : la location des certifications RNCP. Si ce dispositif peut faciliter l’accès à certaines formations, il a parfois donné lieu à des dérives. Des titres ont été « prêtés » sans contrôle rigoureux de qualité, permettant à des structures peu fiables d’obtenir une légitimité apparente. « Ce système est en train d’être réformé pour responsabiliser les certificateurs. Perdre un titre, c’est perdre un actif stratégique pour un établissement », insiste Philippe Grassaud.
Face à cette situation, un projet de loi sur l’enseignement supérieur privé est en préparation. Il vise à structurer l’offre, clarifier les critères de qualité et mieux encadrer les pratiques.
Pour Philippe Grassaud, « ce texte marque un tournant, car il choisit d’intégrer les acteurs privés dans une stratégie nationale au lieu de les marginaliser. C’est une logique de co-construction, qui vise à rapprocher les mondes public et privé de manière constructive. »
Modèle économique sous tension

Si, depuis 2018, le bilan est très positif en matière d’insertion, les problématiques budgétaires et la hausse des standards de qualité impactent considérablement les opérateurs de formation. « Il est donc probable que la situation soit plus compliquée dans les deux ans à venir pour certains acteurs moins exigeants, qui devront trouver un modèle économique cohérent avec un niveau d’exigence accru. Certaines pratiques doivent disparaître et le marché assaini », insiste Annabel Bismuth.
Attention à ce que le stage ne se substitue pas à l’alternance, prévient Laura Penel.
« Si le coût continue d’augmenter, il ne sera plus intéressant d’adopter l’apprentissage. »
Autant de sujets qui sont montés en puissance, tout en favorisant l’essor de l’enseignement indépendant. « Ce qui a sans doute crispé les acteurs publics, comme les universités, qui constatent aujourd’hui que 25 % des jeunes font le choix du privé. Si un phénomène d’aubaine a conduit des officines à profiter des fonds de l’apprentissage sans disposer du savoir-faire, il est sans doute temps de régler la situation avec un projet de loi clair, qui soutienne les acteurs sérieux et reconnus », conclut Philippe Grassaud.
* Le décret prévoit le versement d’un reste à charge obligatoire de l’employeur pour des contrats visant des diplômes ou titres de niveau 6 (Bac + 3) ou plus. Celui-ci est de 750 € par contrat.